MITRAILLEUSES 1914-1918
La Première Guerre Mondiale diffère qualificativement, et quantitativement de tous les précédents conflits humains. C’est la première véritable guerre industrielle, où plus d’hommes furent tués dans la bataille que dans n’importe quel autre conflit antérieur.
Durant la Première Guerre mondiale, la mitrailleuse domina le champ de bataille d’une manière difficilement imaginable aujourd’hui. En fait, il serait exact de dire qu’elle dicta toutes les étapes de la guerre, et cette domination tactique par une seule arme stimula le développement de nouvelles armes capables de la contrer. Tout au long de la Première Guerre mondiale, les stratèges militaires assayèrent désespérément d’endiguer la puissance de la mitrailleuse. Les uns après les autres, les bombardements d’artillerie prolongés labouraient le système défensif de l’ennemi, jusqu’au moment où il semblait que rien ne pu survivre. Mais chaque fois que la malheureuse infanterie sortait de sa tranchée, il semblait toujours y avoir une mitrailleuse pour lui interdire de progresser. C’est ainsi que l’artillerie détruisait pendant que la mitrailleuse tuait. Mais, en termes tactiques, la plupart de celles-ci étaient des armes encombrantes et lourdes, que l’on ne pouvait pas déplacer facilement et rapidement. Une nouvelle génération de mitrailleuses plus légères fit son apparition au cours de la guerre.
Des soldats de l’armée des Indes, sur le front français, font usage d’une mitrailleuse Hotchkis mle 1900.
Ce furent ces nouveaux fusils-mitrailleurs qui permirent en grande partie de rompre avec la pratique des emplacements statiques et les attaques frontales massives, en imposant une nouvelle situation tactique dans laquelle une infanterie relativement mobile pouvait acheminer une bonne proportion de son appui-feu, où et quand le besoin se faisait le plus urgent. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier, quels que soient les succès obtenus avec les fusils-mitrailleurs, que ce fut finalement l’arrivée du char qui permit de briser le véritable hachoir que constituait le réseau de tranchées du front de l’ouest.
Dans cette étude se trouvent de superbe exemple sur la comception des mirailleuses de cette époque: depuis la magnifique Vickers, en passant par le solide PM 1910, jusqu’au déplorable Chauchat.
LA MISE EN OEUVRE DES MITRAILLEUSES
Le commandement français, qui avant la déclaration de la guerre en 1914, avait pour doctrine l’offensive, s’apercu très vite que le feu tuait. Ainsi lui fut révélée la puissance vulnérable des mitrailleuses. Les fantassins allant à l’assaut de l’ennemi voyaient tomber autour d’eux leurs camarades, fauchés par le tir de ces armes terribles dont on a pu dire qu’elles furent la cause de la moitié des pertes de la Grande Guerre. Leur incroyable efficacité surprit tout le monde.
La mitrailleuse n’était pourtant pas une invention récente. Ne parlons pas de ces lance-mitraille du XIVe siècle qui, composés de plusieurs canons rivés sur un affût, pouvaient tirer plusieurs coups simultanément: car si ces engins sont des encêtres lointain de la mitrailleuse, ils furent abandonnés vers 1540. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour voir apparaître la mitrailleuse. Certe, elle n’avait pas encore acquis l’apparence qui sera la sienne de 1914 à 1918. En France, la Montigny comptait 25 canons, à l’arrière desquels se trouvait un plateau où l’on mettait les cartouches; l’introduction de celles-ci dans les tubes était provoquée par un levier.
Des soldats français en manoeuvre dans les Vosges. Au premier plan un malheureux mitrailleur porte une Hotchkiss mle 1900 sur le dos, d’autres se chargent de l’affût et des chargeurs à munitions. On remarque que les fantassins emportent une arme individuelle (fusil ou carabine).
Les mitrailleuses à canons multiples furent utilisées lors de la guerre de Sécession de 1861 à 1865 et lors du conflit franco-allemand de 1870. Plus tard, on chercha à réaliser des mitrailleuses à canon unique et à fonctionnement automatique. Ainsi naquirent les mitrailleuses Maxim, Skoda, Hotchkiss. L’efficacité de telles armes utilisées dans la guerre russo-japonaise de 1904-1905 impressionna les observateurs. De ce fait, l’armée française, à l’instar des autres puissances européennes, développa son emploi. Ayant adopté en 1900 la mitrailleuse Hotchkiss, elle s’équipa de Saint-Étienne en 1907, et ce fut cette même année que la mitrailleuse fit son entrée officielle dans l’armement de l’infanterie.
En dépit d’une existence de plus d’un demi-siècle, au cours de laquelle elle avait eu l’occasion de prouver son efficacité, la mitrailleuse ne fut pas considérée comme l’une des armes de base du fantassin français. Le règlement de 1912 la qualifiait d’arme auxiliaire. Elle ne devait en aucun cas remplacer l’artillerie.
Un cavalier indien, montant en ligne sur le front ouest pendant l’hiver 1915. Par sa légèreté, le FM Lewis était parfaitement adapté pour la cavalerie.
D’une part, il était déconseillé de l’utiliser sur de longues distances, car dans ce cas-là, son tir se diluait et perdait de son impact les résultats obtenus n’étaient pas à la mesure des dépenses en munitions exigées. D’autre part, et toujours en raison du rapport coût/efficacité, il était conseillé de s’en servir uniquement face à un ennemi en formation compacte.
En revanche, il étai admis qu’employée dans un combat rapproché, la mitrailleuse constiuait pour le bataillon ou le régiment une réserve de feu mobile et souple particulièrement efficace, à condition qu’elle intervienne à bon escient et à un point décisif. Devant les carnages provoqués par les mitrailleuses, l’armée française modifia non seulement l’emploi de cette arme, mais également sa façon de faire la guerre. Cela se fit d’abord de manière pragmatique, au coup par coup. Comme les formations denses qui allaient au feu se faisaient faucher par le tir des mitrailleuses, on les fit diluer. Puis, on plaça, comme les Allemands des mitrailleuses en première ligne. Ce ne fut d’ailleurs pas une réussite totale, car cet usage nouveau n’étant pas dans les moeurs, on agit souvent sans précaution; des mitrailleuses, armes lourdes, furent abandonnées, d’autres qui n’avaient pas assez camouflées furent détruites par l’ennemi.
La mitrailleue aérienne MG 08/15 fut convertie en arme à usage terrestre, mais les résultats ne furent pas probants.
En outre, le règlement préconisait le tir de concentration, qui devait être opéré sur des îlos de résistance, des points d’appui, des issues de village, des rassemblements de troupes, des zones de défense, des endroits propices à une contre-attaque, des ravins ou des coupures de terrain pouvant dissimuler des mitrailleuses.
De leur côté les Allemands n’avaient que des seules compagnies régimentaires jusqu’en 1915. En 1916, ils créèrent des compagnies de bataillon, puis après les grandes offensives de Verdun, des détachements de mitrailleuses d’élite. A la fin de la guerre, ceux-ci constituaient des arrière-gardes particulièrement efficaces, qui, transportées de nuit par des camions suivaient par bonds la retraite de leur armée, afin de ralentir la progression française.
Un sous-officier des troupes coloniales allemandes (les Schütztruppen de l’Afrique orientale allemande) tenant une boîte de munitions pour sa MG 08. Cette arme fit merveille.
On peut clore cet exposé sur les mitrailleuses en 1918 sans ajouter qu’elles furent également utilisées dans l’aviation. Une ou deux mitrailleuses étaient montées en tourelles sur les avions multiplaces, tandis que l’on trouvait sur les monoplaces une seule mitrailleuse, pointée dans l’axe de l’avion, et dont les tirs étaient coordonnés au mouvement de l’hélice.
Une section des Highlanders au combat en mars 1918 dans la région de la Somme. Le FM Lewis est utilisé comme arme d’appui-feu. Un sous-officier perché dans l’arbre indique les paramètres de tir au servant.
La Grande Guerre vit l’évolution du rôle des mitrailleuses. D’armes auxiliaires d’infanterie, utilisées pricipalement en défensive, elles furent promues armes usuelles des fantassins. Généralisées à l’ensemble des armées, leur nombre ne fit que croître, leurs missions se diversifièrent, et elles furent employées aussi bien en attaque qu’en défense. Parallèlement, on assista à une décentralisation de leur organisation et de leur commandement. Les chefs de corps qui, en raison même de la rareté de ces armes, s’en étaient réservé l’usage, furent forcés, sous la pression de l’étendue des fronts puis de la guerre de mouvement, de déléguer leurs pouvoirs à leurs subordonnés.
LA VICKERS AU COMBAT
La mitrailleuse Vickers fut mise au point à partir des premières Maxim Gun que la société Vickers avait fabriquées dans ses usines de Crayford dans le sud de l’Angleterre. Bien que la Maxim se soit très bien vendu, et que de très nombreux clients aient été satisfaits, les bureaux d’études de Vickers décidèrent d’améliorer le concept de base pour produire une arme plus légère et plus meurtrière. A cet effet, ils inversèrent le système de verrouillage. Pour mieux comprendre, il suffit d’expliquer ce qui ce passe dans le mécanisme de recul court de Vickers.
Assi devant sa mitrailleuse Vickers au tripier inversé pour surélever le canon dans un but de défense aérienne, ce soldat de L’Anzac prend un peu de repos. La Vickers connut un certain succès dans ce rôle. Des soldats australiens se targuèrent d’avoir descendu le Fokker triplan de von Richthofen.
Au moment de tirer une cartouche, le mécanisme de bascule, formé de deux leviers, est parfaitement dans l’alignement de la charnière centrale. Cela donne au mécanisme un excellent verrouillage. Seul un mouvement vertical peut contrarier la rotule. Les forces de recul n’en sont pas capables car elles ont tendance à repousser le bloc de culasse en ligne droite. Lorsque la balle quitte la bouche du canon, les gaz se dilatent dans une petite chambre à la bouche et repoussent le canon qui, à son tour, donne une impulsison au bloc de la culassse. Le canon et la culasse recule et, ce faisant, l’arrière des deux leviers du mouvement de bascule heurte un butoir en se relevant, ce qui opère le déverrouillage. Le bloc de culasse peut alors revenir en arrière séparément en éjectant la douille de la chambre. On peut, simultanément, recommencer le chargement: en reculant, le bloc de culasse fait pression sur un ressort (connu sous le nom de ressort fusée), qui renvoie le bloc de culasse à sa position normale. Ce processus est continu tant que le tireur appuie sur la détente qui se trouve en avant des poignées de la mitrailleuse.
Un soldat australien enseigne la manière correcte de charger une mitrailleuse Vickers à dos de mule ou de cheval de somme. Ce harnais spécial permettait le transport des munitions, de l’eau, des pièces de rechange, des accessoires de visée et même des canons de rechange.
À l’origine cette vapeur s’échappait à l’air libre par un trou dans le dessus de la chambre de refroidissement, mais on s’aperçu très vite que le jet de vapeur trahissait l’emplacement de la mitrailleuse qui invitait alors des feux de représailles. On apporta une solution rapide à ce problème en forçant la vapeur à passer par un tube flexible pour aller dans un bidon d’eau où elle put se condenser en eau sans danger avant d’être retranvasée dans la chambre de refroidissement. L’avantage de cette solution est manifeste dans les régions désertiques.
Les mitrailleuses Vickers continuent leur tir même après une attaque chimique en 1916. Les masques primitifs de l’époque réduisaient beaucoup le champ visuel, mais ils étaient adéquats. Noter autour du canon la lanière pour emporter l’arme rapidement en cas de besoin.
En dépit du système de refroidissement par eau, il fallait changer le canon toutes les dix milles cartouches. Comme il était tout à fait possible de tirer dix milles cartouches à l’heure au cours d’un combat, l’utilisation de la mitrailleuse exigeait le changement de canon touts les heures. Une équipe bien aguerrie pouvait le faire presque en deux minutes, sans perte d’eau notable, à l’exception des quelques gouttes qui entraient dans le canon quand on l’enfoncait dans la chambre. On doit signaler ici que c’est ce genre d’opération délicate qui exigea bientôt une spécialisation du tireur sur mitrailleuse Vickers. Au début on affecta de simples soldats à ces armes, mais on s’apercu très vite que non seulement l’entretien de l’arme mais encore son utilisation tactique et son réapprovisionnement à longue durée exigeaient une expérience qui mena à la création du Machine Gun Corps en octobre 1915. Peu à peu, les mitrailleuses lourdes en dotation dans les divisions furent regroupées en compagnies au sein de ce nouveau corps. On peut juger de son importance par le nombre de ses effectifs à la fin de la Première Guerre mondiale : 6432 officiers et 12 920 sous-officiers et hommes du rang.
Une équipe de mitrailleurs australiens sur Vickers prennent un avion ennemi qui volait à basse altitude. Pour ce rôle, on avait besoin d’inverser le pied enfin d’accroître l’angle de hausse du canon et il fallait faire attention à la bande-chargeur. Ce système de défense antiaérienne se montra très efficace contre les avions d’attaque au sol allemands qui apparurent en grand nombre en 1918.
Une mitrailleuse Vickers est cachée dans des bâtiments de ferme près de Haverskerque pendant la période de guerre raltivement fluide qui suivit les offensives allemandes au début de 1918. Comme toujours, un soldat dirige le feu du tireur et un autre passe la bande-chargeur.
Un sergent du Machine Gun Corps se sert de sa mitrailleuse Vickers pour un tir rapproché (noter que la mire a été abaissée). Il est personnellement armé d’un revolver et il porte au bras l’insigne du mitrailleur breveté qui n’était octroyé qu’aux militaires les plus chevronnés.
Équipes de mitrailleurs Vickers dans des emplacements spécialement préparés quelque part sur un champ de bataille des Flandres. Cette photo montre les conditions défavorables du terrain au cours de la Première Guerre mondiale, mais la Vickers ne craignait pas la boue.
Une équipe de tireurs britanniques sur Lewis avec une boîte contenant des chargeurs pleins. On peut voir les ailettes de la chambre de refroidissement par air sous le chargeur de l’arme. C’est ailettes étaient censées refouler l’air le long du canon.
Un tireur britannique fait feu avec son F.M. Lewis comme si c’était un fusil, sans aucun doute sur une cible innatendue. Cette manière de tirer n’était pas précise car le poids du canon empêchait un tir prolongé et, avec le recul, l’objectif n’était plus dans le point de mire.
Au combat le Machine Gun Corps ne dédaignait pas d’utiliser les armes capturées comme on le voit sur cette photo d’une équipe britannique se servant d’une sMG 08. L’équipe en avant-plan utilise une mitrailleuse Vickers. Le mécanisme Maxim de la sMG 08 ne présentait aucun problème aux mitrailleurs britanniques.
Cavaliers du Deccan Horse attendant l’occasion de se lancer à l’assaut lors du combat sur la Crète de Bazentin le 14 juillet 1916. La cavalerie ne servit qu’à gêner les arrières et à abuser des convois de ravitailement. Elle était tout aussi incapable de progresser sous le feu des mitrailleuses.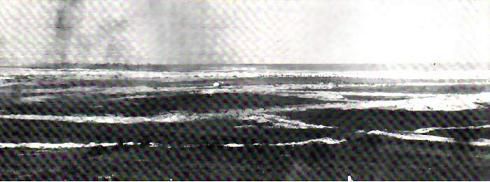
Vue allemande de la progression de l’infanterie britannique en terrain découvert près de Mametz le 1er juillet 1916. Devant un tel objectif, les mitrailleurs allemands avaient beau jeu de mettre fin à un tel assaut, surtout si la ligne de progression traversait le champ d’un tir d’enfilade qui venait des deux côtés.












